Projet de loi immigration et asile 2023, la position des acteurs de la solidarité
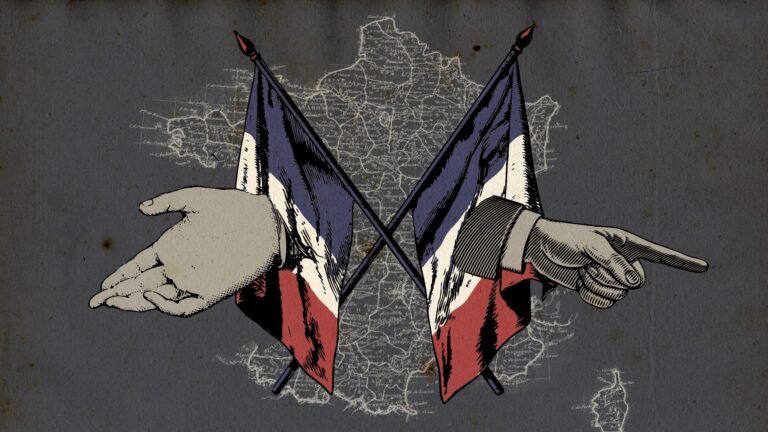
Au titre de sa mobilisation contre la pauvreté et la précarité, la Fédération des acteurs de la solidarité (FAS) prendra toute sa part aux discussions sur une nouvelle loi “immigration et asile” pour porter les constats, attentes et propositions résultant de l’action de ses adhérents dans l’accompagnement professionnel ou bénévole des personnes étrangères trop souvent plongées dans la précarité.
La Fédération et ses adhérents fondent leur action sur des valeurs de solidarité, de dignité humaine, d’accès aux droits fondamentaux, indissociables des exigences d’ordre public et social. C’est forte de ces valeurs intangibles inscrites dans notre droit, d’une exigence intellectuelle qui conduit à se fonder sur les faits et d’une lucidité sur les tensions qui travaillent une société fragilisée par la concurrence des précarités, que la FAS porte des recommandations utiles aux personnes concernées, à ses adhérents et au pays tout entier.
Elle restera intransigeante dans son refus de toutes formes d’essentialisation et de stigmatisation des étrangers, notamment d’assimilation à la délinquance.
L’inconditionnalité de l’accueil protégée par notre droit – toute personne présente sur le territoire doit pouvoir bénéficier à minima d’un hébergement et d’un accompagnement social adapté à sa situation – doit être défendue et respectée comme un principe intangible de la lutte contre le sans-abrisme. Les objectifs de santé publique doivent primer sur les restrictions des droits aux soins de santé des personnes étrangères. Car la situation de nombre d’étrangers en France, y compris des mineurs, et en conséquence des personnes qui travaillent et s’engagent à leurs côtés dans les associations, est marquée par la précarité en raison des impasses dans lesquelles les plonge une succession d’obstacles, tel un « mur administratif ». De l’accès aux préfectures et à l’OFII pour l’obtention ou le simple renouvellement d’un titre de séjour, en passant par l’accès au travail, jusqu’à une prise en charge médicale effective, leurs parcours sont trop souvent semés d’embûches, tout le contraire de « profiteurs du système ».
Ce sont des dizaines de milliers de personnes qui sont maintenues dans la précarité du fait des défaillances d’un système résultant d’une conception dissuasive des politiques d’immigration aux dépens de nos traditions d’asile, de la dignité des personnes, de l’ordre social et du dynamisme économique du pays. Ces dysfonctionnements devenus systémiques, qui pèsent sur les agents publics comme sur les travailleurs sociaux et les bénévoles, portent atteinte aux politiques publiques de solidarité (logement, hébergement, santé physique et mentale). Privés de titres de séjour, ces étrangers ne peuvent pas obtenir un travail déclaré, un logement, des soins. Ils sont maintenus dans la dépendance d’un accompagnement assuré, entre autres, par les adhérents de la Fédération, paradoxalement financé par la même puissance publique qui les plonge dans la précarité. Les politiques de solidarité permettent d’assurer un soutien essentiel à des personnes qui ne disposent pas des ressources pour subvenir à leurs besoins, mais il est dans l’intérêt de tous que chacun soit en mesure de s’en émanciper lorsqu’ils/elles sont amenés à rester durablement sur le territoire.
Ces pratiques dissuasives dégradent les conditions de travail des professionnels du travail social, des bénévoles et des fonctionnaires qui accueillent et accompagnent les personnes étrangères. Il est crucial de sortir des absurdités administratives qui se répercutent sur les conditions d’exercice de leurs missions. De plus, plutôt que de tenter régulièrement de faire porter la responsabilité des échecs de politique migratoire sur les associations, il serait préférable de respecter les expertises des professionnels du travail social et de ne pas leur faire assumer des prérogatives de contrôle migratoire qui ne peuvent être les leurs, et de privilégier les partenariats de bonne foi avec les associations.
La Fédération des acteurs de la solidarité en appelle à un profond changement de méthode : l’accueil doit devenir la norme ; les reconduites, des exceptions justifiées ; l’un et les autres devenant pleinement effectifs. Les moyens de l’administration doivent être d’abord tournés vers la facilitation de l’accès au séjour et de l’intégration. A cet égard, l’inflation des obligations de quitter le territoire français (OQTF) – la France en délivre beaucoup plus que ses voisins européens et les exécute peu – constitue une erreur du point de vue de la situation de la plupart des personnes, de la satisfaction des besoins de l’économie et de l’efficacité de l’action publique. Elles devraient être concentrées sur des personnes constituant un problème lourd d’ordre public.
Les efforts de l’administration devront se concentrer sur un objectif : éviter les situations de non-droit qui alimentent la précarité, en élargissant les critères de délivrance des titres de séjour et en privilégiant des titres stables, pluriannuels. La France doit garantir un accès effectif et rapide au séjour aux motifs du droit d’asile, d’une protection humanitaire complémentaire pour les personnes en détresse humanitaire ne pouvant être renvoyées dans leur pays d’origine, d’une protection environnementale et d’un accès au travail au regard des besoins structurels de notre économie. Les droits à la réunification ou au regroupement familial et l’accès des étudiants étrangers à notre système d’enseignement supérieur doivent être défendus. L’élargissement des critères et procédures de délivrance de titres de séjour pour le travail doit pouvoir concerner les personnes en situation irrégulière qui exercent aujourd’hui une activité, mais aussi celles qui sont empêchées de travailler en raison de leur (non) statut administratif. Cette facilitation de l’accès au travail doit se faire de manière souple et pérenne afin de sortir des complexités administratives et éviter que les personnes ne dépendent que de la volonté des employeurs.
Ces mesures doivent être accompagnées d’un investissement significatif dans les politiques d’intégration, tout particulièrement pour les femmes, dans une logique d’intervention précoce : favoriser l’apprentissage du français, la formation professionnelle, l’insertion économique, l’accès au logement, à la santé, à la culture et aux loisirs. Tout cela le plus tôt possible après l’arrivée sur le territoire.
La crise ukrainienne, au-delà de ses spécificités, a montré que l’accueil est possible mais aussi qu’un changement d’approche, y compris dans le travail entre l’État (et en son sein pour retrouver une approche interministérielle), les collectivités, les associations et les citoyens, est nécessaire pour sortir des effets de précarisation et de crispation sociale de décennies de réflexes dissuasifs.
Pour lire la note dans son ensemble:
https://www.federationsolidarite.org/wp-content/uploads/2022/11/22112022_Positionnement-Immigration_VF-1.pdf